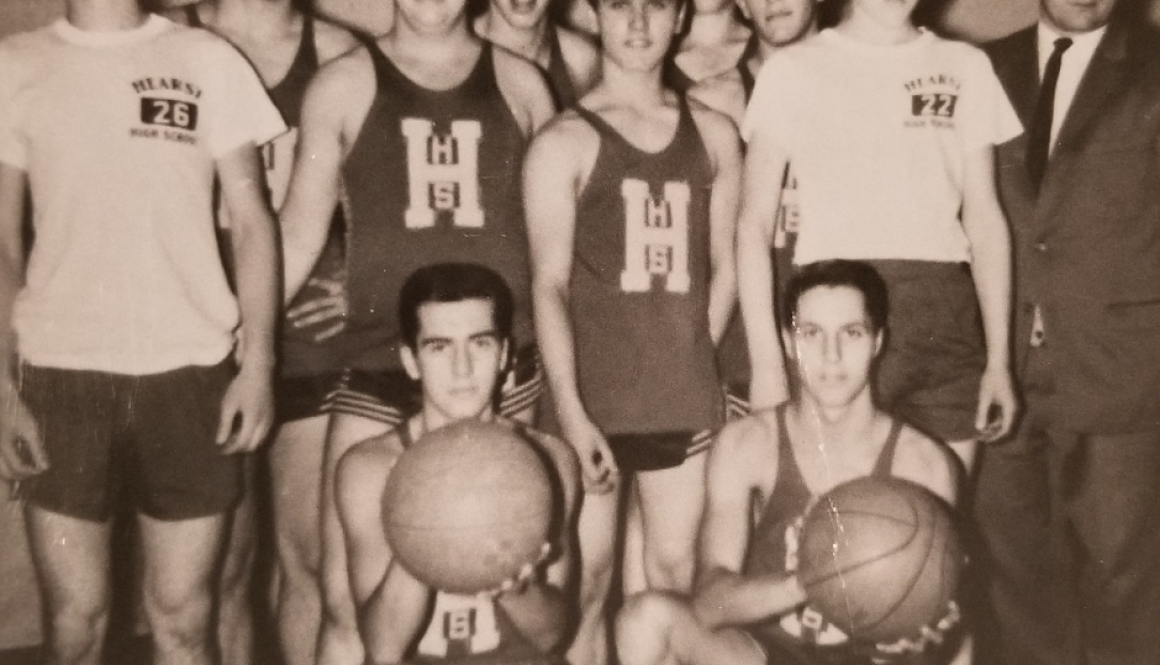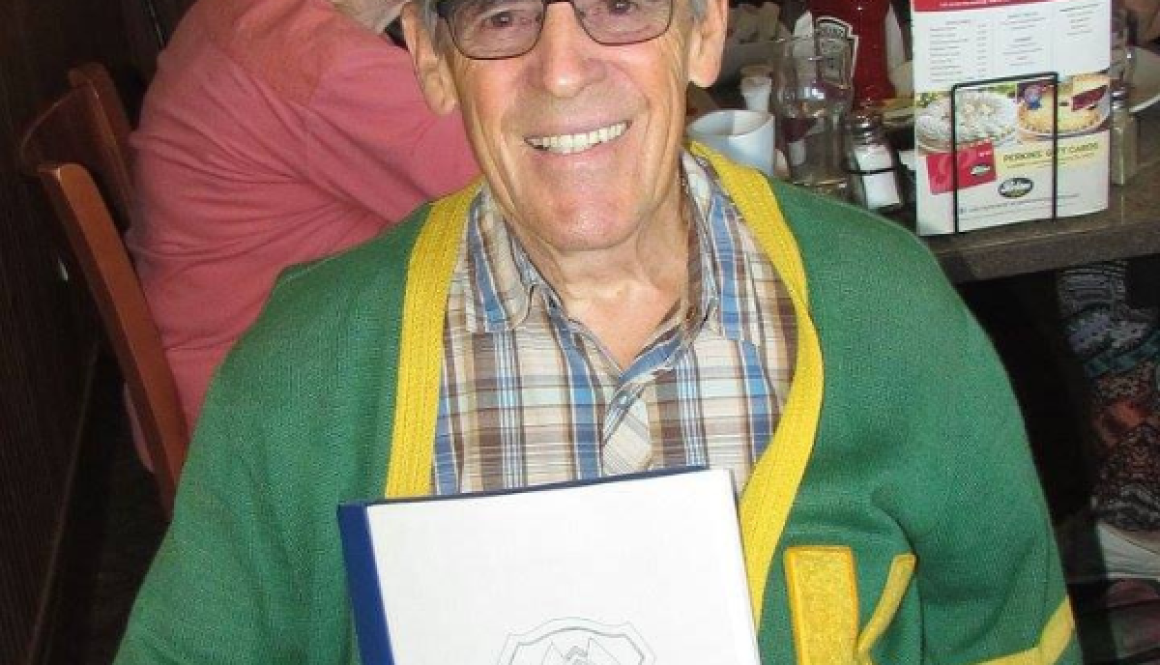Dans le temps comme dans le temps – Le bucheron et la coupe du bois : Partie 1 – Le travail du bucheron avant les années 50
À noter : la majeure partie des faits historiques utilisés dans ce récit sur le travail du bucheron provient du texte de Ian Radford « Woodworkers of the Pulpwood Logging Industry of Northern Ontario », La Société historique du Canada, Volume 17, Numéro 1, 1982. Je note que chaque compagnie de bois avait aussi certaines procédures individuelles.
La journée du bucheron commence habituellement avant la levée du soleil. Le déjeuner est suivi d’une longue marche à partir du dortoir (bunkhouse) jusqu’au site de la coupe du bois. Le chef des bandelettes de bois (strip boss) alloue à chaque bucheron une bandelette (strip) d’environ 66 par 660 pieds. Le bucheron doit premièrement se faire un sentier au milieu de la bandelette, nettoyer les sous-bois et enlever les branches, les arbres morts et tout autre matériau qui pourraient nuire au débusquage des billots. Il planifie ensuite sa coupe pour s’assurer que les arbres tomberont de manière à faciliter l’empilage et le débusquage.
Une fois que le bucheron a déterminé où faire tomber l’arbre, il fait une entaille assez profonde dans le tronc avec sa hache, juste au-dessus du sol. Ensuite, avec sa scie à buches (bucksaw) il se met à scier l’autre côté de l’arbre à la hauteur de la coche créée par la hache. Lorsqu’il ne reste qu’un ou deux pouces entre la coche de la hache et le trait de scie, le bucheron doit pousser l’arbre dans la direction de la coche pour le faire tomber dans l’endroit prévu. C’est un travail éreintant. Lorsque l’arbre est tombé, le bucheron procède ensuite à l’ébrancher et le couper en longueurs requises.
Vers la fin de la journée, le bucheron empile ses billots avant qu’ils soient mesurés et débusqués jusqu’au bord du chemin. Un sondage effectué en 1941 démontre que l’empilage du bois était le travail le plus difficile pour le bucheron. Ce travail était rendu encore plus difficile par les pluies d’automne, les marécages, la température et la bise du nord-ouest. Si le bucheron se mettait à suer dans une température très froide, il ne pouvait pas se reposer de peur de geler. En hiver, la neige épaisse traversait souvent les vêtements et le froid ralentissait son travail.
La coupe de bois était aussi dangereuse. Les bucherons manipulaient des outils de coupe tranchants avec leurs mains, souvent en se tenant debout sur un sol gelé. Peu de bucherons portaient des vêtements protecteurs parce que ça les ralentissait. Plusieurs bucherons ont subi de graves blessures causées par des arbres qui tombaient. L’industrie forestière avait le plus haut taux d’accidents de toutes les industries en Ontario. Ainsi, les employeurs payaient le plus haut taux de compensation dans la province.
Pour plusieurs, le travail du bucheron avait un attrait spécial qui amenait certains hommes à travailler incroyablement fort et même à risquer leur santé. Il n’y a pas de doute que l’esprit « machismo » faisait partie de l’image du bucheron et certains aimaient le travail difficile et dangereux. Pour d’autres, la vie de bucheron représentait un rapprochement avec la nature. Pour la plupart, cependant, la coupe de bois leur permettait de faire un bon montant d’argent pour quelques mois de travail en hiver.
La variété du travail, comparée au travail monotone dans les manufactures, était aussi attirante. Il y avait un rythme saisonnier au travail. La coupe de bois se faisait en automne jusqu’au Nouvel An, le charriage du bois commençait avec les premières neiges, et au printemps on faisait souvent la drave sur les lacs et les rivières.
Le travail du bucheron exigeait une adaptation constante aux conditions de l’environnement. Chaque bandelette présentait des défis singuliers. Les meilleurs bucherons planifiaient leur coupe, analysant où le bois devait tomber pour faciliter l’ébranchage, le débitage et le pilage de billots. Le bucheron devait aussi considérer les troncs d’arbres courbés, les résidus de feux de forêt antérieurs, la cime inégale des arbres, les vents violents… De même, le meneur de chevaux qui transportaient les billots devait prendre les meilleurs sentiers, gérer les côtes et les marécages, évaluer constamment la pesanteur de la charge de billots selon les conditions du terrain, savoir quand les chevaux avaient besoin de repos… Plusieurs bucherons venaient de la campagne avec peu d’éducation, mais ils savaient utiliser les connaissances et habiletés apprises lors de la coupe d’arbres sur les fermes.
Le bucheron avait aussi beaucoup d’indépendance au travail. Il passait une grande partie de la journée à travailler dans sa propre bandelette, isolé des autres. Le contremaitre n’avait pas le temps de visiter tous les bucherons. D’ailleurs, le bucheron était évalué selon le produit de son travail, c’est-à-dire le nombre de billots empilés à la fin de la journée. Le bucheron organisait par lui-même la coupe et tout le travail à faire dans sa bandelette.
Les employeurs avaient tendance à donner les meilleures bandelettes aux bucherons qui produisaient le plus, dans le but de maximiser la productivité. Ceci explique pourquoi 80 % du bois a été coupé par 20 % des bucherons de la compagnie Abitibi dans le district du Sault. Les salaires étaient semblables partout dans l’industrie, et c’était accepté que les meilleurs bucherons étaient forts, efficaces et gagnaient de très bons salaires.
Photo : Circa 1930 – Bûcheron Ivor Friske près de sa pile de bois – photo de la famille Nevala – Albums Alan Jansson – provient de Écomuséee de Hearst