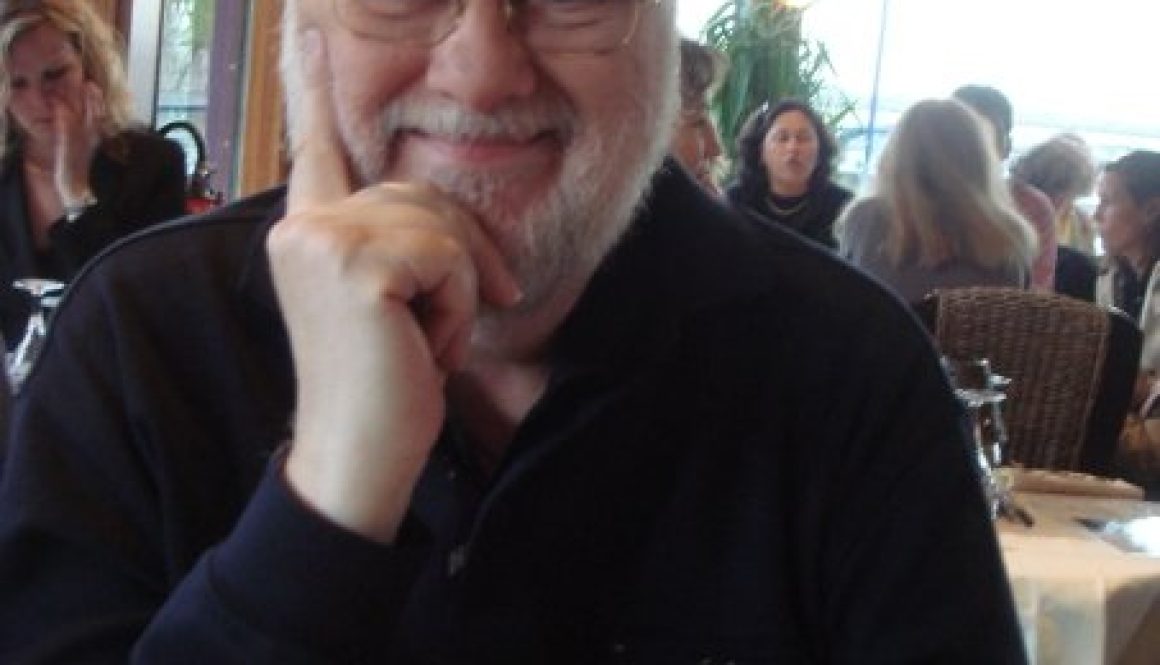Investissement pour la formation en santé en français dans le Nord de l’Ontario
Le gouvernement du Canada investit des millions de dollars dans la formation en santé en français dans le Nord de l’Ontario. L’objectif est d’améliorer l’accès à des services de santé en français, surtout dans les régions rurales et éloignées.
_______________________
Ju – IJL – Réseau.Presse – Le Voyageur
L’Université Laurentienne reçoit 7 millions $, l’Université de Hearst reçoit 2 millions $, le Collège Boréal 4 millions $ et le Réseau du mieux-être francophone du Nord de l’Ontario (RMEFNO) 1 million $.
Le ministre fédéral de la Santé, Jean Yves Duclos, était de passage au Collège Boréal de Sudbury pour annoncer la répartition des montants. L’argent provient du Plan d’action pour les langues officielles 2023-2028. « Le programme de santé pour les langues officielles en santé de Santé Canada est conçu pour améliorer l’accès aux soins de santé dans la langue officielle que l’on choisit », dit le ministre Duclos.
Le président du Collège Boréal, Daniel Giroux, souligne que ce financement est essentiel pour maintenir un niveau de services adéquat et essentiel. « Une personne vulnérable dont la santé est défaillante se doit de pouvoir compter sur des services de santé de qualité dans sa langue, peu importe l’endroit où la personne demeure. »
À l’Université Laurentienne, le montant sera géré par le Consortium national de formation en santé CNFS – Volet Laurentienne. Le CNFS appuiera les programmes de formation de santé en français, comme Sciences infirmières, de Service social, l’Orthophonie.
« Présentement, on travaille beaucoup sur le recrutement. On veut aller chercher plus d’étudiants qui vont pouvoir devenir nos futurs professionnels de la santé qui vont pouvoir offrir des services dans les communautés en situation minoritaire en français », explique la gestionnaire du CNFS-Volet Laurentienne, Chanelle Landriault.
Les fonds pourront entre autres servir à des stages pour que les étudiants découvrent les communautés en manque de personnel, précise Mme Landriault.
Le Collège Boréal utilisera les fonds pour ses programmes en santé : hygiénistes dentaires, préposés aux bénéficiaires, technologue en radiation médicale, ambulanciers et infirmières auxiliaires.
« Comme collège en situation minoritaire, les couts sont beaucoup élevés pour développer et maintenir la formation » , dit Daniel Giroux. Sans l’appui financier du gouvernement, il est aussi plus difficile d’offrir des cours et de la formation dans les communautés éloignées, ajoute-t-il.
Le président du RMEFNO, Collin Bourgeois, souligne que le million appuiera ce que l’organisme fait déjà. Le rôle du RMEFNO est entre autres de faire la promotion et de la formation pour que les diverses agences de santé offrent des services en français. « Former, informer et faire une distribution [des services] à parts égales. Chaque région doit avoir un complément de service de santé en français », rappelle M. Bourgeois.
À l’Université de Hearst, l’argent servira surtout à appuyer la formation offerte dans le programme de psychothérapie.

Lapointe-Duclos-Serré.JPG
La députée fédérale de Sudbury, Viviane Lapointe, le ministre fédéral de la Santé Jean Yves Duclos, le député fédéral de Nickel Belt, Marc Serré.
Photo : Julien Cayouette