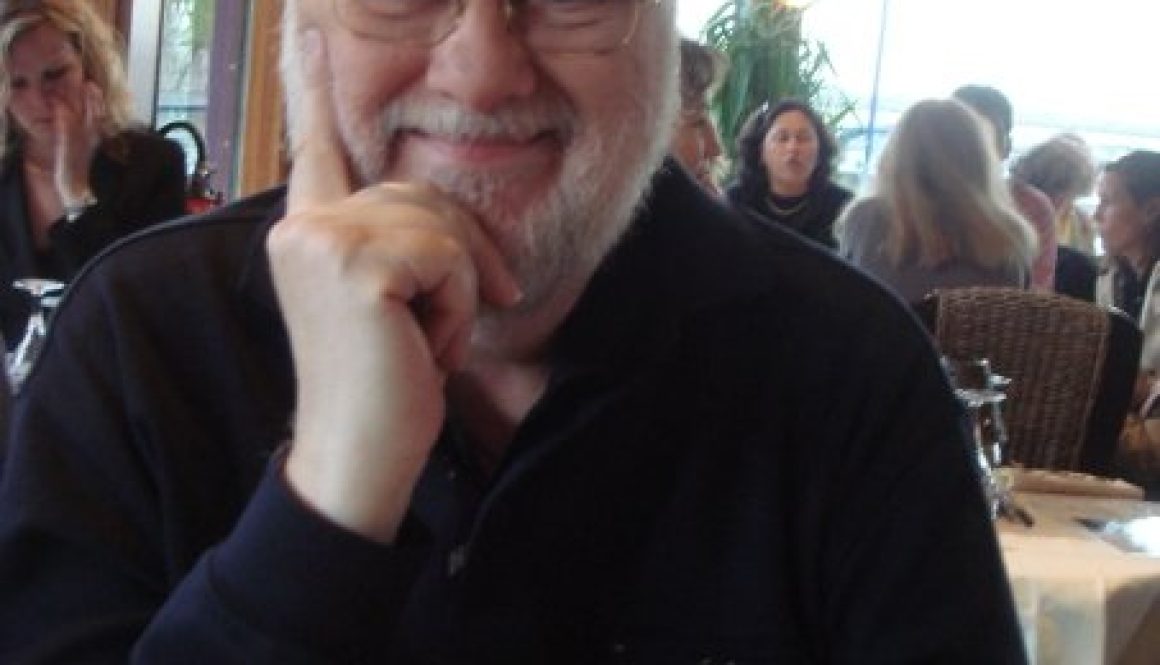Théâtre Action a été essentiel à l’expansion du théâtre en français en Ontario. Il ne l’a pas créé, mais il lui a permis d’être reconnu, d’obtenir du financement, de se distinguer et de se perpétuer. Atteindre 50 ans est d’autant plus impressionnant pour un organisme « caméléon », qui a réussi à se réinventer plusieurs fois.
_______________________
Julien Cayouette – IJL – Réseau.Presse – Le Voyageur
Théâtre Action a été essentiel à l’expansion du théâtre en français en Ontario. Il ne l’a pas créé, mais il lui a permis d’être reconnu, d’obtenir du financement, de se distinguer et de se perpétuer. Atteindre 50 ans est d’autant plus impressionnant pour un organisme « caméléon », qui a réussi à se réinventer plusieurs fois.
Il y avait du théâtre en français en Ontario avant 1972. Il était animé par des troupes amateurs, bénévoles et étudiantes qui travaillaient en silos, sans échanger. Dans cette forme, il ne pouvait pas évoluer.
Plusieurs actions décisives sont à l’origine de la création de Théâtre Action (TA). Plus particulièrement une réunion de l’organisme Theatre Ontario à l’été 1971 où « huit participants de langue française, ayant pris conscience de leur communauté d’intérêts, [ont] refusé de s’intégrer aux ateliers de langue anglaise », peut-on lire dans l’album des 35 premières années de Théâtre Action, écrit par Joël Beddows et Amelie Mercier.
Ce qu’avance le premier « French officer » du Conseil des Arts de l’Ontario (CAO), Richard Casavant, c’est que ces huit participants (Richard Casavant, Jeanne Sabourin, Pierre Bélanger, Luc Clouâtre, Denis Courville, Jacqueline Martin, Sr. Micheline Poirier et Nicole Tessier) ont formé leur propre groupe à sa suggestion.
Au début de la conférence, chacun des huit était à une table différente avec un groupe d’anglophones. « À la pause, j’ai dit à Jeanne : “ On va faire ça autrement. Réunis les francophones, on va se réunir dehors parce que je veux savoir quelles sont leurs réalités et s’il y a lieu de continuer cette réunion, cette conférence dispersés comme nous le sommes “ », raconte M. Casavant. Ainsi est né le Groupe Arc-en-ciel.
- Casavant avait baigné dans le milieu théâtral, ayant participé aux activités d’un petit théâtre d’été dans les années 1960. Il a quitté la pratique pour entrer au CAO, mais l’un de ses objectifs a toujours été de faire avancer le théâtre franco-ontarien, de l’aider à se distinguer des pièces classiques et québécoises.
Mais lors de cette réunion, M. Casavant se devait de rester discret, de ne pas trop montrer ses cartes ou d’avoir l’air de revendiquer, puisqu’il était un observateur du gouvernement. «Les actions que je vais faire doivent être assez discrètes. Mais mon but à moi, c’est d’avoir une association, éventuellement, qui va offrir des services d’animation» et de communication entre les théâtres. Un organisme qui rencontrerait les critères de financements du CAO.
À ce moment-là, très peu de compagnies de théâtre franco-ontariennes se qualifiaient pour des subventions. Or, comme agent du CAO, c’était la meilleure façon pour M. Casavant d’arriver à ses fins.
Il dit s’être battu pour obtenir des fonds et demander à Pierre Beaulne de produire un rapport. Ce rapport a souligné le retard des troupes de théâtre francophone par rapport aux anglophones et la « nécessité de créer un organisme de développement en vue de stimuler une activité théâtrale de langue française », écrivent Beddows et Mercier.
Une action dans la mouvance
En entrevue, Joël Beddows rappelle que Théâtre Action est né dans « un grand mouvement interventionniste sur le plan culturel et identitaire ». Il y avait eu le Rapport Saint-Denis, à la fin des années 1960, qui niait l’existence d’une culture franco-ontarienne distincte et avançait que les francophones de l’Ontario ne pourraient jamais s’émanciper du Québec.
Les actions et les rapports suivants ont activement contredit cette prémisse. Surtout face au repli des francophones du Québec sur eux-mêmes.
« Théâtre Action est devenu le lieu qui proposait les activités, de ce qu’on dirait aujourd’hui, de médiation-culturelle, qui faisait en sorte que cette idée de mettre au monde une identité et une culture pour l’accompagner, trouverait preneur permis la population générale. Ce qui est également important je dirais, c’est que dès le départ, Théâtre Action a adopté le principe de la décentralisation », argumente M. Beddows. Cette décentralisation était importante selon lui en raison de la répartition de la population francophone.
Ce mouvement identitaire du début des années 1970, rappelle Joël Beddows, est « contreculturel, contestataire, ça se positionne dans les actions contre une conception traditionnelle conservatrice religieuse de la culture canadienne-française, aussi contre le bilinguisme institutionnel ». TA ne s’identifie pas directement avec ces valeurs, mais baigne dans cette atmosphère et est parfois menée par des gens qui y adhèrent.
« C’était un projet étrangement bien réfléchi pour une gang de jeunes. Étrangement bien articulé pour des gens à peine formés » en théâtre, ajoute M. Beddows.
Richard Casavant considère également que les Éditions Prise de parole ont eu un grand rôle à jouer dans la création du théâtre franco-ontarien en publiant très tôt les textes de pièces. « Le théâtre, une fois que c’est dit, c’est dit. Ça ne reste pas nécessairement comme quelque chose qui est écrit. Bien heureusement que Prise de parole a publié les textes d’André Paiement dès le début. » Pour lui, théâtre et littérature s’entremêlent et s’entraident.
Naissance à Sudbury ?
La création de Théâtre Action est associée à Sudbury. La décision a effectivement été prise à l’Université de Sudbury au début mai 1972, lors d’un forum provincial organisé par le Groupe Arc-en-ciel.
« Théâtre Action regroupait, pour la première fois dans l’histoire du théâtre franco-ontarien, tous les gens qui s’occupaient directement ou indirectement du théâtre dans la province », a écrit Pierre Beaulne dans son rapport sur la rencontre.
Le nom Théâtre Action, dont Richard Casavant réclame la paternité, y a été utilisé pour la première fois. Mais pour lui, TA n’a pas nécessairement été créé à Sudbury. L’idée était née plusieurs mois plus tôt, ailleurs. Les actions pour mener à sa création avaient été faites en consultant plusieurs troupes de partout en province. La promulgation de sa création a eu lieu à Sudbury, quelques mois après la présentation de Moé j’viens du nord, s’tie!, mais aurait très bien pu avoir lieu ailleurs.