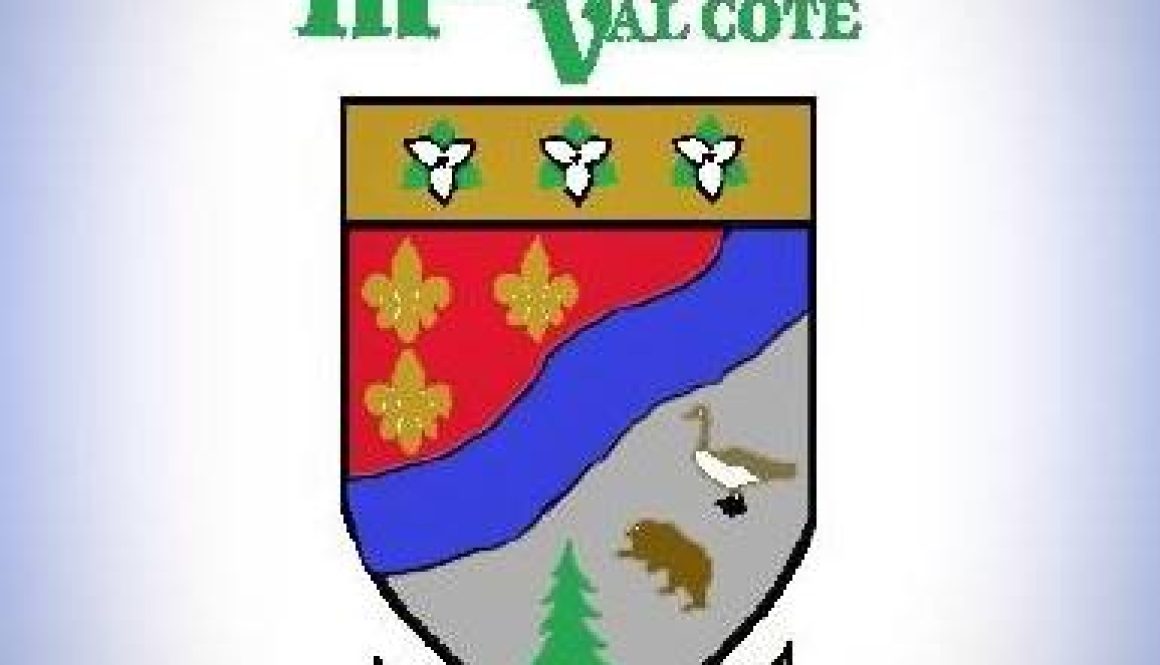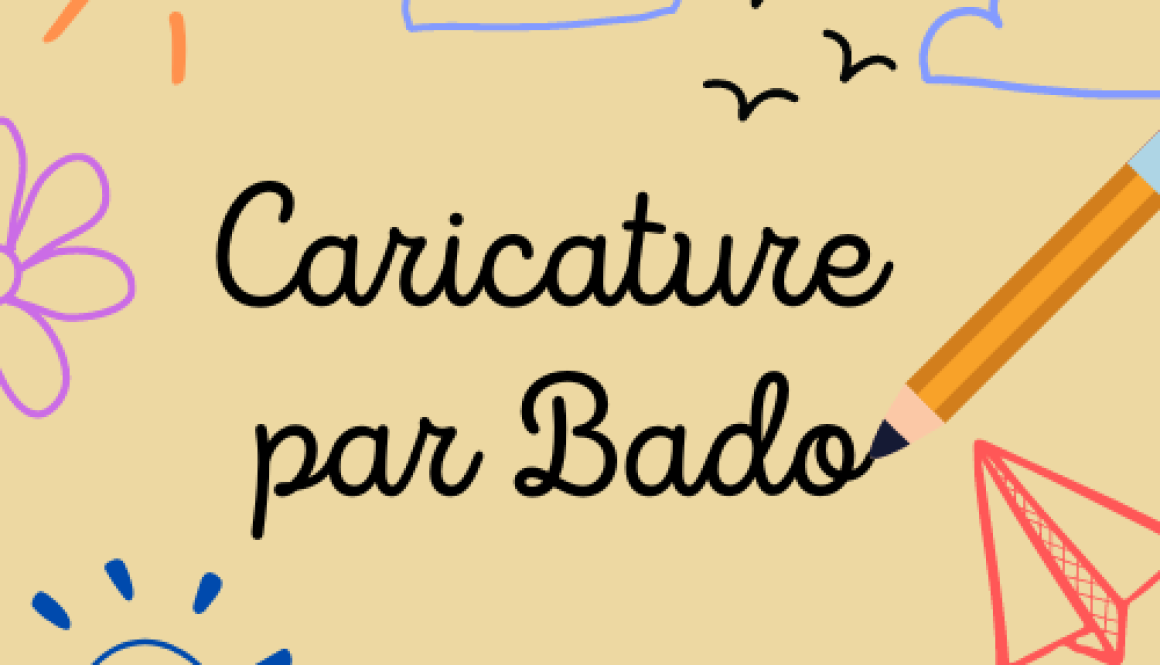Le dernier rapport d’Equifax Canada rapporte un sommet historique des soldes de cartes de crédit atteignant 107,4 milliards de dollars au deuxième trimestre et la dette reliée à la consommation est de 2,4 milliards. Les taux d’intérêt très bas ont fait en sorte que les Canadiens dépensent davantage à crédit, toutefois l’inflation risque de causer certains mots de tête aux consommateurs et même d’être très dangereux.
Les compagnies comme Equifax mesurent l’endettement, et tout indique que la population canadienne est actuellement à risque. Si les taux d’intérêt continuent d’augmenter, les familles du pays devront s’adapter. « Si plusieurs personnes d’un même quartier se mettent à vouloir vendre leur maison, l’offre augmente et force le prix des maisons à baisser », explique Marc Bédard, professeur en économie à l’Université de Hearst. « Si ça baisse beaucoup, même les banques et les caisses ne seront plus protégées, car elles ne pourront pas couvrir la totalité de l’argent prêté à la base lorsque la valeur était élevée. Dans ce cas-là, c’est la Société canadienne d’hypothèques et de logements, qui a assuré les maisons, qui doit payer les institutions financières, sachant très bien que si elle doit commencer à protéger de plus en plus de maisons, c’est elle qui va faire faillite, comme on a vu aux États-Unis avec la crise de 2008. Chaque fois qu’on monte de 1 % le taux d’intérêt, ça fait en sorte que des gens ne seront plus capables de rembourser leur hypothèque et s’il y en avait trop en même temps, on pourrait se retrouver dans une crise économique. »
Depuis avril 2022, la Banque du Canada a passé le taux directeur de 1 % à 5 % aujourd’hui. « Le but, c’est d’appauvrir les gens pour mettre de la pression et réduire l’inflation. Le type d’inflation que l’on vit depuis trois ans n’est pas causé par la demande, mais bien par l’offre. Ceux qui créent les produits ont monté artificiellement les prix pour faire plus de profits », ajoute le professeur de l’UdeH. Il semble que la Banque du Canada n’obtient pas les résultats espérés puisque deux augmentations de 0,25 % se sont ajoutées au cours de l’été. « Plus les gens sont endettés, pire c’est. Parce qu’on a plus de jeu, on peut tous emprunter à un certain point (…) et bien au Canada on a presque atteint le maximum d’endettement. C’est surtout la classe moyenne qui est endettée énormément », s’inquiète M. Bédard.
Le professeur en économie indique que deux types de dettes sont possibles. Premièrement, la dette hypothécaire permet d’avoir quelque chose de tangible et qui ne devrait pas perdre de valeur une fois le prêt remboursé. « Toutes les autres dettes, ça c’est dangereux parce que s’il y a une hausse des taux d’intérêt, tu te retrouves dans une position où les gens ne sont plus capables de rembourser ».
L’importance de l’éducation financière
La planificatrice financière Marie-Hélène Lanoix-Verreault explique que la structuration au niveau des finances personnelles est très importante pour éviter un endettement trop élevé. Elle indique qu’il y a plusieurs outils pour aider les épargnants à modifier leurs habitudes de consommation dans les temps plus difficiles comme en ce moment. « Le désir de tout posséder dès l’âge adulte est un phénomène de plus en plus fréquent partout au pays. Nos parents en ont fait des sacrifices pour pouvoir être où ils sont aujourd’hui. L’envie d’avoir une voiture neuve, une belle maison, une roulotte et des véhicules de loisirs le plus rapidement possible, on voit ça plus avec les nouvelles générations », dit-elle.
Depuis le début des années 2000, le taux d’intérêt a presque toujours été près de 1 %. Toutes les générations devront maintenant s’adapter. « Tout allait relativement bien depuis vingt ans, donc les gens sont moins préparés à l’éventualité que leurs finances se portent moins bien. C’est peut-être un moment d’apprentissage pour la société, c’était un peu trop facile quand ça ne devrait pas l’être. Il faut apprendre, il faut être débrouillards, il faut budgéter et mettre nos priorités en place. »
Un citoyen canadien peut avoir autant de cartes de crédit qu’il le désire. Avec des taux passant de 8,99 % à 29,99 %, ces bouts de plastique peuvent facilement faire perdre le contrôle des finances familiales. « Le montant minimum d’intérêts à payer est toujours calculé sur le plus gros montant enregistré sur la carte, jusqu’à ce qu’elle retourne à zéro. Donc, pour les gens qui ont plusieurs cartes de crédit, il serait préférable de s’attaquer à la dette de la carte possédant le plus haut taux d’intérêt en premier et de payer le minimum pour les autres », propose la planificatrice financière.
Portrait local
Dans le but de brosser un portrait de l’endettement des ménages de la région, Pierre Richard, directeur général de la Caisse Alliance, a indiqué au journal Le Nord que l’économie locale va généralement bien. « Les gens travaillent et ont les mêmes revenus, donc ce que nous observons c’est qu’ils se serrent un peu plus la ceinture. À l’épicerie, ils vont faire des choix différents et peut-être consommer moins de vêtements et de repas au restaurant. Les gens en mettent peut-être un petit peu plus sur les cartes de crédit en se disant qu’ils vont le payer plus tard », affirme-t-il.
Malgré cela, les demandes pour rencontrer un conseiller financier ont connu une hausse. « Malheureusement, les gens viennent souvent nous voir quand il est trop tard pour recevoir de l’aide et faire des changements sérieux dans leurs habitudes de consommation », souligne Pierre Richard. « Nous n’avons pas émis plus de nouvelles cartes de crédit qu’auparavant, mais les soldes ont augmenté un peu. La hausse du taux d’intérêt a cependant changé l’habitude de consommation des gens. Les ventes de voitures et de véhicules récréatifs ont ralenti légèrement », dit-il.
La faible hausse de l’endettement hypothécaire pourrait être reliée à la hausse des prix des maisons au Canada, mais aussi à la hausse du taux directeur qui influence directement les taux d’intérêt négociés sur une hypothèque, surtout pour les emprunteurs ayant choisi le taux variable. « Il y a deux situations possibles : d’un côté il y a les gens qui sont soucieux de leurs finances et qui mettent leur maison à vendre pour déménager dans quelque chose de plus petit, ils ne sont pas stressés de vendre. Ceux que leur hypothèque était à échéance dans la dernière année, ils ont passé d’un taux d’intérêt à un, deux, trois pour cent à du cinq, six, sept pour cent, donc pour eux ça représente un gros impact au renouvèlement. C’est pour ça aussi qu’on voit des maisons à vendre, des gens pour qui leur paiement va augmenter au renouvèlement et qui ne sont plus capables de se le permettre autant qu’avant. C’est pour cela que l’impact des taux d’intérêt qui montent n’aura pas un impact immédiat sur les hypothèques, ça prend toujours quelques années avant de voir l’impact complet » explique M. Richard.
Il n’y a pas que du négatif à la hausse des taux, les épargnants possédant des placements peu risqués ont vu l’intérêt augmenté de trois à cinq pour cent.