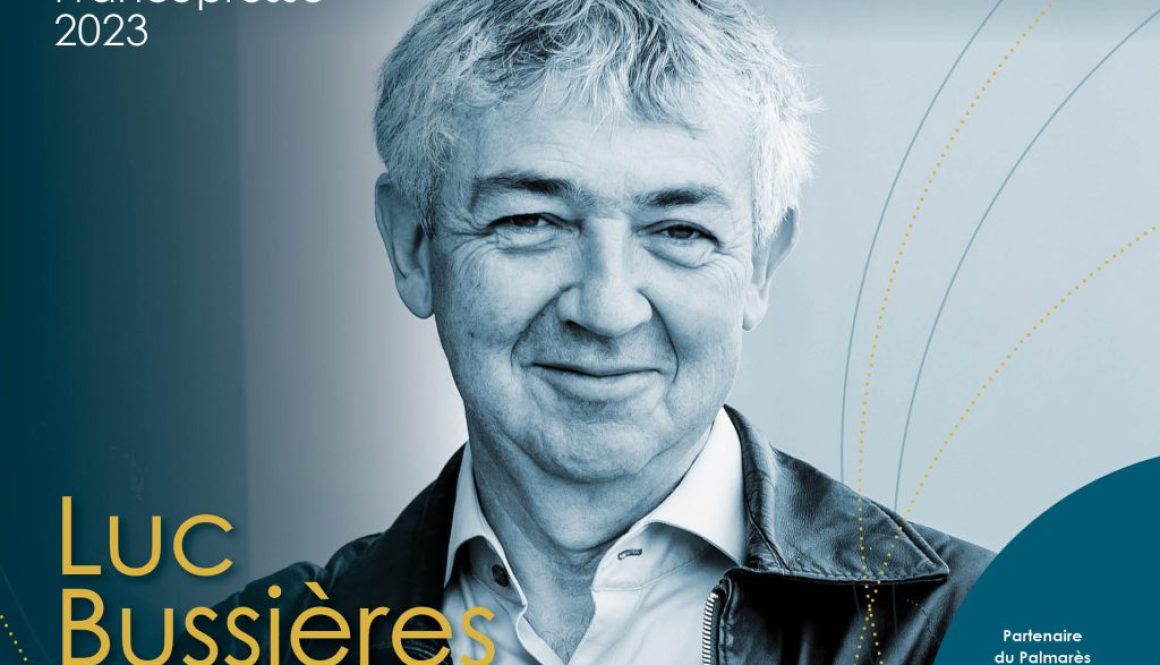Luc Bussières reconnu pour son impact en francophonie
Le recteur de l’Université de Hearst, Luc Bussières, a été ajouté au palmarès des dix personnalités influentes de 2023 dans la francophonie canadienne de Francopresse, le 3 janvier dernier. Ses efforts considérables pour que son établissement s’épanouisse et l’obtention du statut d’indépendance reçu l’année dernière démontre l’impact que M. Bussières a dans la communauté franco-ontarienne. Après plus de sept ans à la tête de l’Université de Hearst, Luc Bussières a des sentiments mitigés face au prochain grand tournant de sa vie, la retraite.
Il a passé les trois dernières décennies au sein du personnel de l’Université de Hearst. Pour lui, il s’agit d’une deuxième maison juste de l’autre côté de la rivière. Être recteur d’une université de petite envergure est une réalité différente des autres, mais c’est ce caractère atypique qui la définit. « Moi, j’ai toujours été bien là-dedans et j’ai toujours dit qu’il faut arrêter de s’excuser. Si jamais on l’a fait, il faut arrêter de le faire. De s’excuser d’être petit, d’être francophone, d’être géographiquement où on est… c’est qu’on est et ça fait partie aussi de nos forces. »
M. Bussières croit qu’il faut trouver des façons de valoriser ces limitations et d’en faire quelque chose de positif. Pendant des décennies, l’Université de Hearst était bien connue pour son rôle dans l’éducation postsecondaire des gens du nord-est de l’Ontario. Son statut plus régional a changé depuis, avec l’arrivée d’étudiants en provenance de 25 pays différents. « Nous sommes restés une université régionale bien implantée ici pour les gens d’ici, mais on amène aussi des gens de l’extérieur, donc on est comme n’importe quelle université au Canada. On a des assises territoriales, mais ouvertes à recevoir des gens de partout. »
Dans les dernières années, l’équipe de l’Université a travaillé beaucoup sur son positionnement pour faire comprendre que l’impact d’une boite ce n’est pas juste sa taille ou son nombre d’employés, surtout pas juste sa localisation. Un gros travail a été effectué pour changer la réputation et la notoriété de l’institution. « On recevait en visite le ministre George Pirie, ancien maire de Timmins, et j’ai aimé un commentaire qu’il a émis. Il disait qu’il fallait arrêter de dire que Hearst c’est loin de tout. “ Ce n’est pas vrai, vous êtes au centre, entre les Grands Lacs et la baie James ! Vous êtes dans une région remplie de ressources, il y a tout ce qu’il faut pour développer ici une économie prospère et une démographie en croissance ”, disait-il. »
Malgré les défis des dernières décennies à Hearst, les jeunes qui ne reviennent pas après leurs études ou qui quittent avant de fonder une famille, l’économie qui prend un coup lorsque l’industrie du bois est en récession, M. Bussière croit qu’il ne faut pas perdre la faculté de rêver et de croire en nous. C’est dans cette optique que certains changements sont venus transformer l’Université de Hearst. « J’ai été impliqué une quinzaine d’années dans l’organisation des voyages qu’on faisait à l’étranger. J’étais fasciné de voir nos étudiantes et étudiants qu’on amenait ailleurs vivre le choc culturel ouvrir les yeux plus grands et apprendre pleins de choses, laisser tomber les préjugés et apprendre comment on vit ailleurs et comprendre mieux les réalités d’ailleurs. Je me disais que ça valait de l’or dans l’éducation de quelqu’un, ça. Nous nous sommes demandé en 2014 : comment pourrions-nous faire pour amener des gens d’ailleurs ici ? En plus, notre communauté en bénéficierait. »
En 2014, les quatre premiers étudiants internationaux ont rejoint les bancs de l’institution et dix ans plus tard ils sont plus de 250 à provenir d’ailleurs. Ils forment la grande majorité du corps étudiant et certains restent même dans la région pour s’y installer après leurs études. Les trois villes sur lesquelles l’UdeH possède un campus sont de plus en plus multiculturelles, des familles métissées se sont créées et des amitiés aussi.
Après son premier mandat de quatre ans, M. Bussières a décidé de continuer puisque l’université voyait partir la même année Marc Bédard et Lyne Poliquin, qui occupaient tous les deux des postes de direction. L’autonomie était à la portée de la main et c’est dans cette optique qu’il a continué. « À cette époque-là, l’équipe de direction était composée de cinq personnes, nous aurions été trois sur cinq à quitter en même temps. Il y avait des choses que nous avions entreprises que je désirais terminer. J’ai beaucoup de passions que j’ai dû mettre de côté un peu par manque de temps, c’est pour cela que je veux me déposer et occuper mon temps avec ces passetemps. »
Une fois son mandat terminé en juin, le recteur n’a pas de plans et c’est ce qu’il veut poursuivre pour le moment. Il aimerait toutefois profiter d’un petit répit avant de se lancer dans de nouveaux projets et mettre ses idées en action. « Je crois que je suis encore plein d’énergie et que je peux encore avoir une contribution quelque part, où que ce soit. Il me reste encore six mois et beaucoup de choses pourraient se passer durant ces mois-là. Sans faire de fausse modestie, ce n’est pas possible d’arriver à faire des choses significatives quand on est seul. »
Malgré les hauts et les bas, les réussites et les inquiétudes face aux financements, Luc Bussières croit que son université ne vit pas de grands déboires financiers qui perdurent. Sur les sept dernières années, six ont été terminées avec un léger surplus financier. L’Université de Hearst a été mise sur la liste des 15 universités ontariennes nécessitant un plan de redressement, mais M. Bussières affirme que le portrait qui a été brossé ne représente qu’une année.
Photo : courtoisie