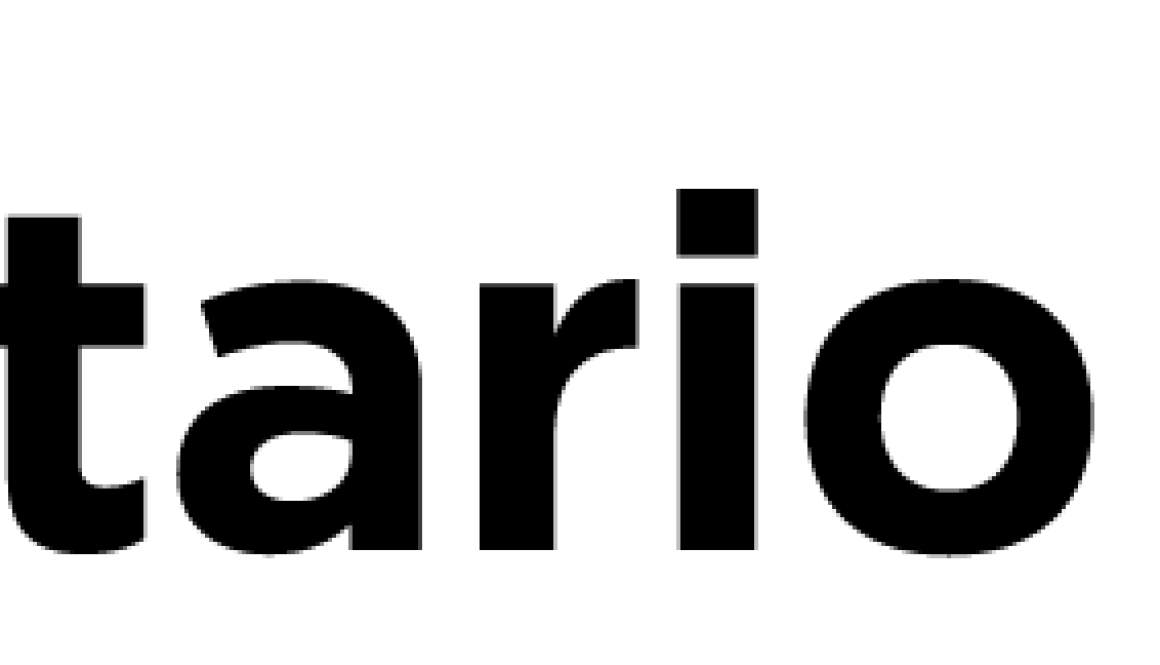Union pour exiger la reconnaissance des pompiers forestiers
Dans un communiqué de presse, plusieurs députés du parti néo- démocrate de l’Ontario se sont joints à l’OPSEU/SEFPO pour une conférence de presse demandant au gouvernement de répondre aux préoccupations urgentes en matière de sécurité des pompiers forestiers de tout l’Ontario.
Le chef adjoint de l’opposition officielle du NPD, Sol Mamakwa ; la porte-parole en matière de CSPAAT et de travailleurs blessés, Lise Vaugeois ; le porte-parole en matière de ressources naturelles et de foresterie, Guy Bourgouin ; et le porte-parole en matière de travail, Jamie West, sont tous des députés du Nord de l’Ontario.
Les députés dénoncent que les pompiers forestiers sont confrontés à de graves difficultés en raison du refus du gouvernement Ford de les classer dans la catégorie des pompiers. Bien qu’ils soient exposés à des toxines et qu’ils ne soient souvent informés des risques pour la santé qu’après avoir signé leur contrat, les conservateurs ont voté contre les amendements du NPD qui auraient accordé aux gardes forestiers des protections accrues et une reclassification de leur emploi.
« Nous sommes confrontés au changement climatique, avec des saisons des incendies de plus en plus longues et volatiles, a déclaré Mme Vaugeois, mais les travailleurs qui s’exposent au danger pour protéger nos communautés ne sont même pas classés comme pompiers. Ils sont exclus de la couverture médicale présumée accordée à tous les autres pompiers de l’Ontario. »
Les pompiers forestiers sont exposés quotidiennement à des toxines cancéreuses et on leur dit que tout ce dont ils ont besoin pour se protéger est un bandana.
« L’année dernière, sous le gouvernement conservateur de M. Ford, il manquait 50 équipes de gardes forestiers, ce qui a mis à rude épreuve ceux qui risquaient déjà leur sécurité pour gérer les incendies de forêt », a déclaré M. West. « Alors que les travailleurs de la lutte contre les incendies de forêt continuent de faire campagne pour la reconnaissance, de l’équipement de protection individuelle et une rémunération équitable, le gouvernement Ford a ignoré leurs demandes, mettant en péril leur bien-être et la sécurité des communautés de l’Ontario. »
« L’été approche à grands pas, et le manque alarmant de préparation aux éventuels incendies de forêt est une préoccupation majeure », a ajouté M. Bourgouin. « Malgré les températures records et les faibles chutes de neige de cet hiver, le gouvernement Ford n’a toujours pas réglé les problèmes de dotation en personnel et mis en oeuvre les solutions proposées par nos pompiers forestiers. Il est temps d’agir et de s’assurer que nos gardes forestiers disposent d’équipes complètes à partir d’aujourd’hui. »
« Je suis reconnaissant aux pompiers forestiers qui travaillent dur chaque année dans tout le Nord pour gérer des incendies records avec des ressources minimales », a conclu M. Mamakwa. »
Les pompiers forestiers du SEFPO sont allés à Queen’s Park pour s’assurer que le gouvernement les écoute. Ils disent avoir les solutions nécessaires pour améliorer leur santé et leur sécurité au travail.
Photo : Canva