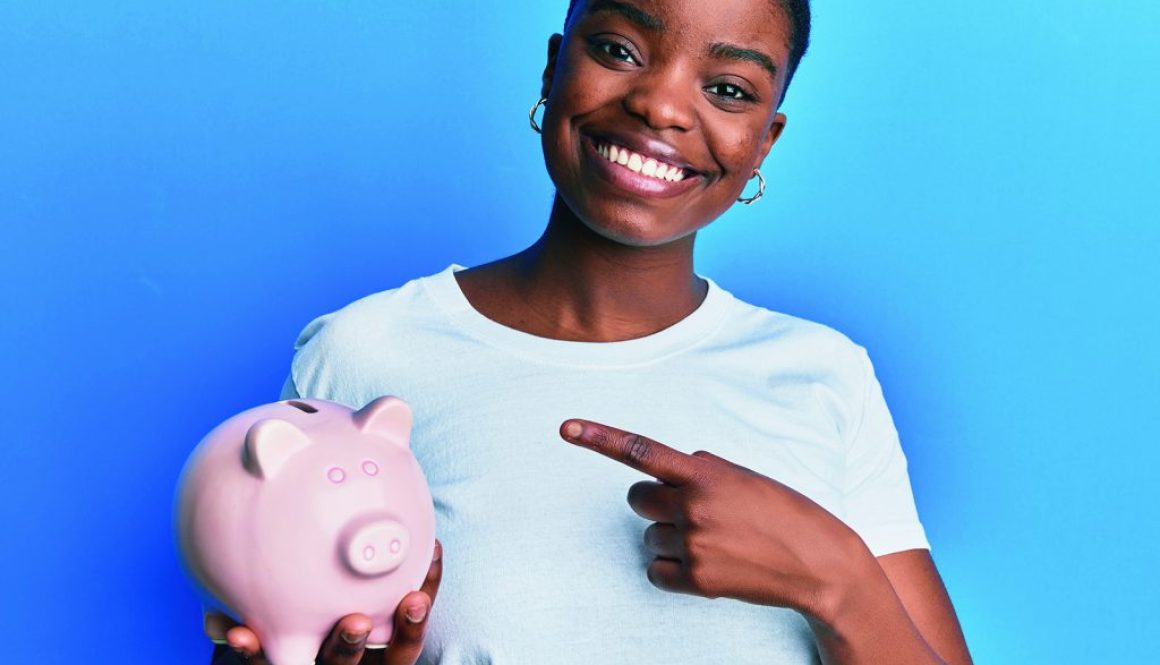La Fierté Communautaire selon une citoyenne Chantal Dillon : petit ne veux pas dire inadéquat
Une petite communauté accueillante vaut autant qu’une grande ville. C’est ce que déclare la citoyenne de Hearst et présidente de la Corporation de logements sans but lucratif, Chantal Dillon. Pour avoir vécu toute sa vie dans la région, elle qualifie sa ville de bienveillante envers les nouveaux arrivants et les clients de l’Intégration Communautaire. « Je te dirais que je suis bien fière de l’accueil », affirme-t-elle. « Les clients sont bien reçus, les nouveaux arrivants sentent qu’on est une communauté chaleureuse et que tout le monde est bien accepté. » Ce qui semble faire le charme de la petite ville, c’est le sentiment d’appartenance que l’on y développe. Contrairement à une grande métropole, Hearst, pour Mme Dillon, se veut sécuritaire avec une multitude de services qui viennent amplifier l’entraide communautaire. « Tout le monde se connait ou presque, on connait tous quelqu’un qui connait quelqu’un », dit-elle. « On a de bonnes activités qui sont offertes pour les jeunes. Je trouve que c’est bien, une petite communauté, car on peut sentir que l’on en fait vraiment partie. » Elle prône aussi les bienfaits d’une collectivité plus petite, lorsqu’il est question d’éducation. À l’école, les classes comptent moins d’élèves, ce qui permet d’offrir une éducation plus rapprochée des besoins de chacun. De plus, la taille de la ville semble ne pas affecter la possibilité de se procurer l’essentiel pour vivre. « Je trouve qu’on a une bonne variété de magasins, puis je pense que c’est important de favoriser l’achat local, d’encourager ces entreprises-là si on veut continuer à en avoir. » En plus d’être présidente de la Corporation de logements sans but lucratif, elle siège aussi au Comité d’accessibilité de la Ville de Hearst. Elle se dit donc bien placée pour voir une lacune, qui semble faire l’unanimité chez les citoyens, celui du manque de logements. « Je ne crois pas surprendre personne en disant qu’on a un problème de logement, j’irais encore plus loin en disant que ça prend définitivement des logements pour personnes âgées, avec du soutien », déplore-t-elle. « Ça allègerait la liste d’attente pour le foyer de longue durée ou à l’hôpital. Ça permettrait à bien des personnes de vivre dans leur appartement, mais avec des services adaptés à leurs besoins. » Oeuvrant sur cette problématique, elle considère que c’est l’une des choses que notre petite communauté a à améliorer